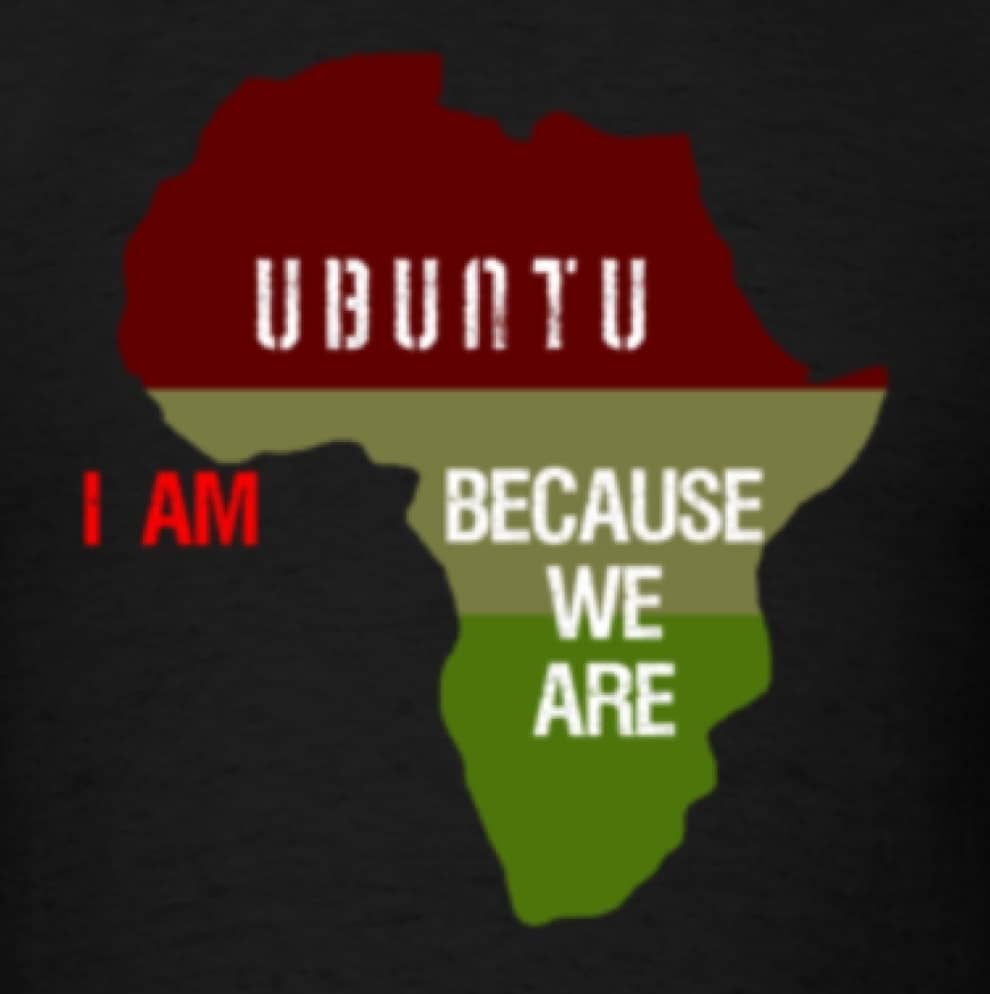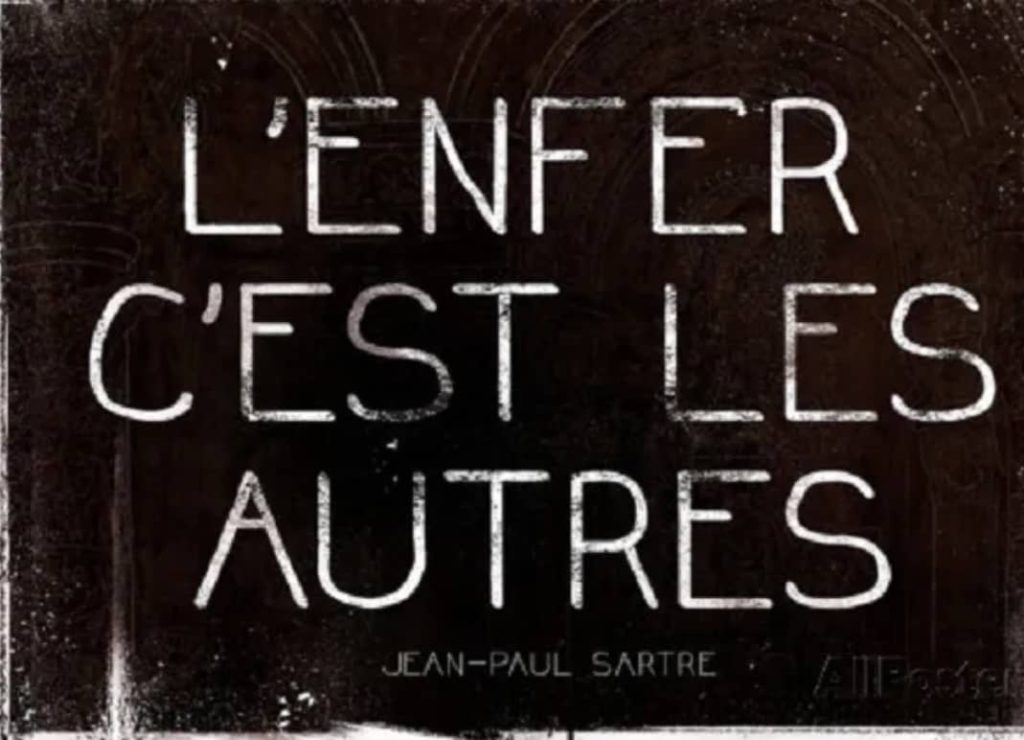
Que serions-nous sans les autres? C’est là une question complexe qui traverse les âges, imprègne les relations sociales, au point que le traitement réservé à autrui passe pour être un trait culturel. Passés les soubresauts qui ont rendu le « contrat social » nécessaires, voire obligatoire, la collaboration avec autrui n’est toujours pas un automatisme, même dans les sociétés qui se targuent d’être communautaires et communautarisantes. Au Japon, autrui se cache derrière le mur de « la retenue », sa présence permet d’exercer, en tout honneur, son devoir de courtoisie, de loyauté, de fidélité et d’obéissance mutuelles. Au Cameroun, autrui s’invite et crie à l’unisson comme pour confirmer qu’il est grégaire. Il doit être présent pour écouter, consoler, conseiller.
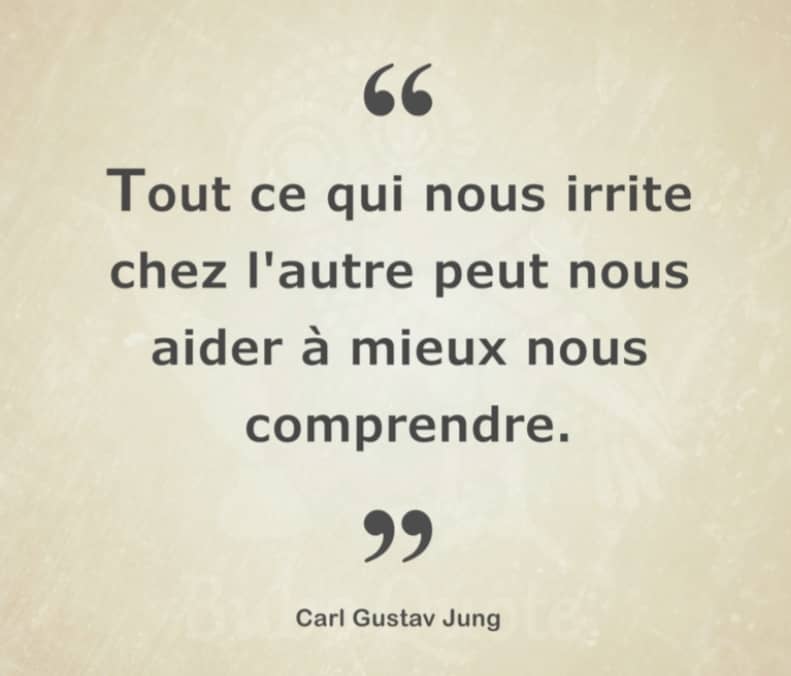
JAPON: de la « névrose japonaise au hikikimori », comment l’autre s’évite.
Au Japon, la relation à autrui est fortement marquée par une attitude spécifique : enryo (遠慮). Sa traduction la plus simple est la retenue polie, le refus poli, ou la réserve et la modestie. L’enryo c’est une forme de contrôle social qui prescrit de ne pas trop s’imposer, ni trop attendre ou exiger des autres. Il faut se conduire envers autrui en gardant la mesure. Adopter des réactions et paroles mesurées. L’enryo peut se manifester par une certaine réserve dans les interactions sociales, un refus poli d’une offre, ou une hésitation à exprimer ses besoins ou désirs. Cette habitude de se retenir devant l’autre, poussée à son paroxysme chez certains, serait à l’origine de certains troubles psychologiques apparentés à la phobie sociale. Morita Shôma, un célèbre psychiatre et psychothérapeute japonais a formulé dès 1930 une théorie sur la phobie interpersonnelle « taijin kyōfu » et popularisé une forme de psychothérapie « la théorie de Morita », basée sur la cure de l’éreuthophobie, la peur de rougir, de rougir de honte.
La peur d’avoir honte, parce qu’on fait honte, poussée à l’extrême, peut être à l’origine du retrait social de l’individu. Il évite toute interaction avec autrui afin de ne pas vivre le moment désagréable de la honte. Nous sommes là au cœur de la phobie interpersonnelle.
L’idée que tout culture produit des personnalités névrotiques, adoptée par Morita, le conduit à une culturalisation de la phobie interpersonnelle.
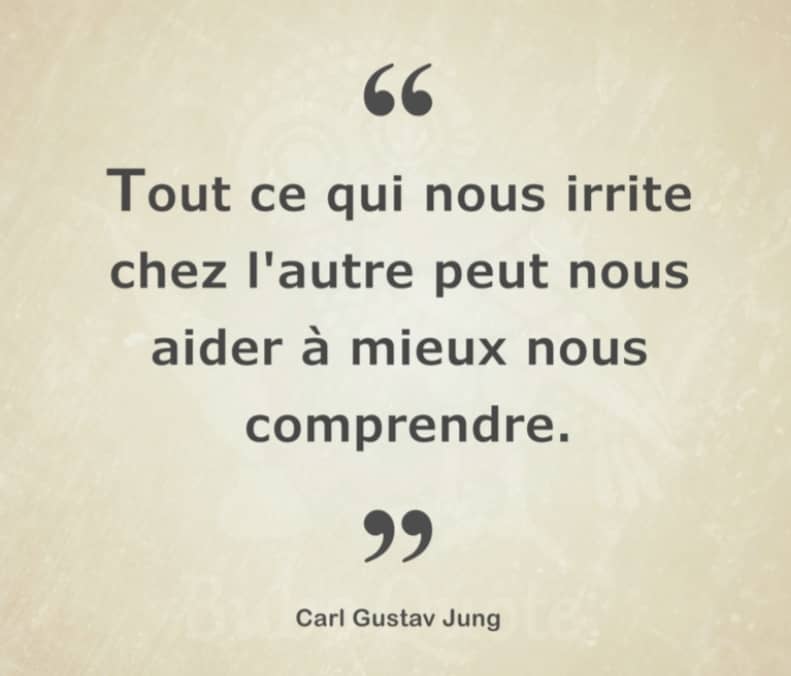
Le taijin kyōfushō (対人恐怖症) devient un syndrome psychiatrique lié à la culture japonaise. Littéralement, il désigne le trouble (shō 症) lié à la peur (kyōfu 恐怖) des relations interpersonnelles (taijin 対人). C’est un trouble psychique à la base duquel on retrouve le sentiment de honte éprouvé dans les relations sociales, une espèce de honte de ressentir de la honte en public. Ce syndrome est la manifestation d’une angoisse dans l’interaction avec autrui. Il traduit ainsi la crainte ou la conviction qu’a un individu de représenter une gêne ou une nuisance pour autrui. Ce qui pousse cet individu à éviter le moindre contact social, pour ne pas avoir à affronter les autres et l’altérité en général.
La névrose japonaise (véritable nationalisation de la névrose interpersonnelle) serait ainsi le reflet pathologique des normes culturelles nippones. Une déclinaison pathologique du principe de l’enryo, où la retenue et la réserve exigées dans les interactions normales au Japon, ont pour conséquence l’exacerbation de stratégies d’évitement et finalement un retrait social de nature phobique.
Ainsi, certains psychologues et psychiatres japonais pensent que la culture et la psychologie nippones favorisent des tendances anthropophobiques spécifiques, et alimentent une certaine anxiété névrotique dans les rapports à autrui. Il en est peut-être ainsi de l’hikikomori.
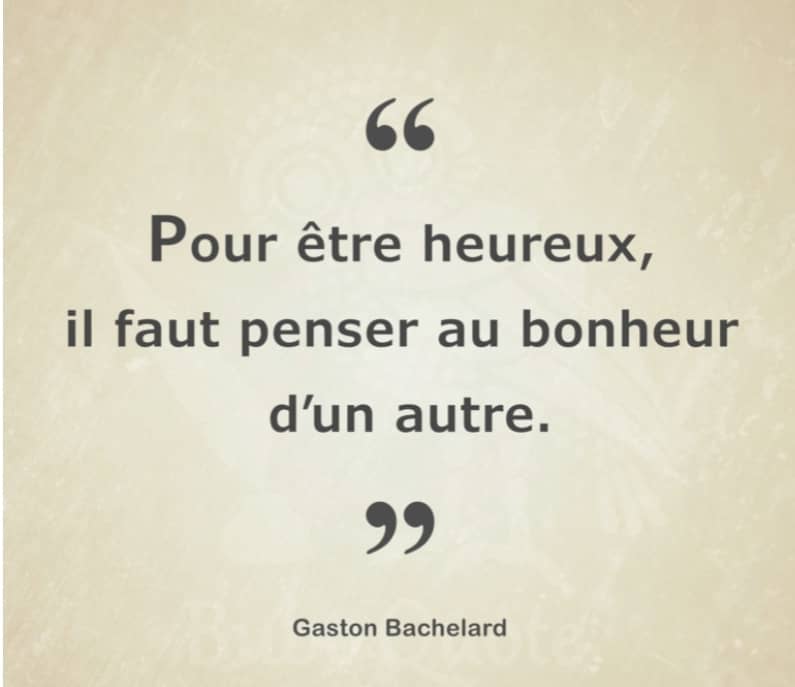
Dans le début des années 1990, en pleine crise économique, le Japon livre au monde un spécimen étrange socialement contrarié: l’Hikikomori (引き籠もり). Pour la majorité des hommes, les hikikomori sont des individus qui vivent cloîtrés chez eux depuis plus de 06 mois. Ils vivent dans leur chambre, ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels, quand les toilettes sont hors de la chambre). Pendant cette période de réclusion volontaire, leurs parents et proches s’occupent d’eux. Ils ne font plus rien d’autre que de se cacher aux yeux du monde. Ils ne travaillent plus, ne vont plus à l’école, ne rencontrent personne, n’ont aucun ami, passent leur temps à dormir, à regarder la télévision, à jouer sur leur ordinateur ou à surfer sur internet, tout ça sans pour autant souffrir d’une maladie mentale spécifique. Les hikikomori préfèrent se cacher plutôt que d’affronter le regard de leurs congénères. Parce que selon eux, tout regard juge et condamne. Il faut éviter autrui afin de ne pas être jugé et condamné. L’isolement des hikikomori peut durer longtemps, un an, dix ans, vingt ans. Des travailleurs sociaux essaient de sortir les individus de cette mauvaise passe, avec la collaboration des familles. Cependant les avis des thérapeutes sur la conduite à tenir face aux hikikomori divergent, il en est de même entre les japonais, qui préfèrent attendre que l’adolescent récalcitrant réémerge dans la société par la force des choses et grâce au soutien à domicile.
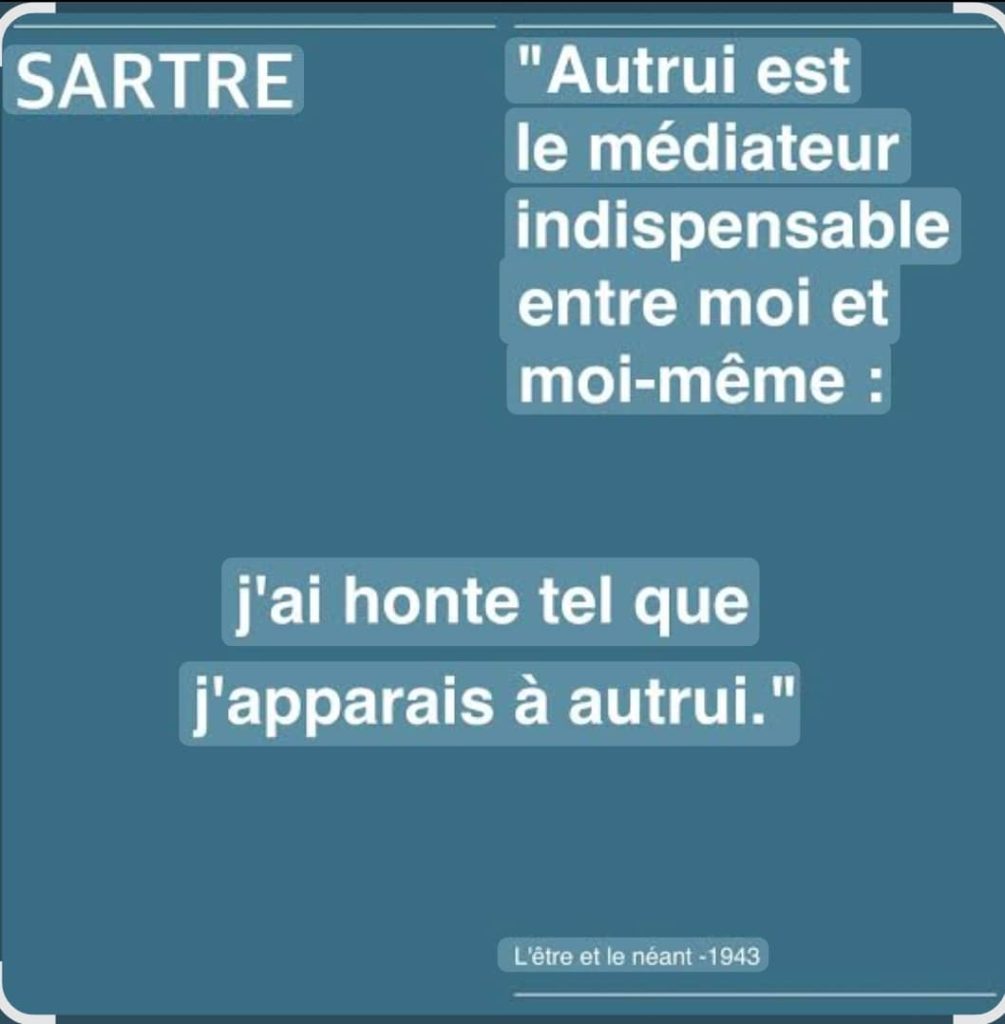
Quand le phénomène commence à se répandre, il touche surtout des adolescents et de jeunes adultes. Aujourd’hui on trouve des hikikomori âgés de 40 à 59 ans, une étude dénombre même 613.000 hikikomori âgés de 40 à 64 ans. En 2024, on a recensé tout de même 1.400.000 hikikomori au Japon.
Le manque de contact social et l’isolement prolongé ont un effet dévastateur sur la santé mentale des hikikomori. Ils perdent le sens des réalités, le caractère asocial et psychopathologique de leur mentalité se renforce, d’autant plus que leur poste de télévision ou leur ordinateur devient alors leur unique point de référence.
La peur qu’ils ont des autres peut se transformer en colère et leur manque de références morales peut les conduire à des comportements violents voire criminels. Certains hikikomori attaquent leurs parents. En 2000, un hikikomori de 17 ans a pris le contrôle d’un bus et tué une passagère. Un autre cas extrême est celui d’un hikikomori ayant enlevé et séquestré une jeune fille pendant neuf ans. Un autre a tué quatre fillettes afin de reproduire une scène de manga. Les comportements de violence légère sont toutefois souvent difficiles à établir car les familles préfèrent taire la vérité. Avoir un fils ou une fille hikikomori à la maison est encore un sujet tabou, un des derniers bastions du haji (恥), « la honte, le déshonneur ».

CAMEROUN: quand l’autre s’invite, l’individu s’effrite?
Difficile d’imaginer un hikikomori au Cameroun. Il faut déjà que l’individu dispose d’une chambre où il peut se cloîtrer et vivre sans les autres mais avec le soutien des autres. Déjà, beaucoup de jeunes camerounais partagent leur chambre avec un frère où sœur, les incursions des parents sont fréquentes dans cette chambre. Promiscuité et intimité restreinte empêchent toute tentative de réclusion. Il y a aussi que les autres aiment à se mêler de ce qui ne les regarde pas, qu’ils peuvent bien casser la porte d’une chambre pour tuer dans l’œuf tout tentative de réclusion volontaire.
Et, tout le monde le sait, si on veut être aidé par les gens, il faut savoir être avec les gens. La vie c’est le ndjangui, la cotisation, je te fais aujourd’hui, tu me fais demain. Je gagne aujourd’hui grâce à vous, demain quelqu’un d’autre gagne grâce à mes efforts et à ceux des autres.
Impossible d’éviter autrui. Même si on est un pauvre égoïste. Même si on est un fieffé radin ou le plus taciturne des misanthropes. Même si on n’attend rien des autres, le réseau touffu des relations sociales oblige les individus à faire avec les autres.
D’ailleurs, les gens semblent aimer que les autres se mêlent de leur vie, ils guettent la moindre approbation, qu’ils accueilleront avec plus ou moins de modestie. Ils guettent aussi la moindre désapprobation, qui leur permettra de se plaindre d’être vilipendés par les jaloux (ceux-là qui jettent des pierres aux arbres qui portent les plus beaux fruits). En tout cas, il n’est pas mauvais de savoir ce qui arrive à son prochain, non pas pour alimenter les commérages et les médisances, mais pour s’enquérir de sa santé, pour savoir si le malheur et la malchance ont enfin déserté sa maison, si la prospérité est revenue, s’il faut redoubler de prières et d’intercessions, s’il faut organiser une quête, une visite réconfortante, etc.
Certains pensent avec nostalgie à la vie d’avant, où les gens étaient liés par des solidarités, des amitiés, des fraternités et des allégeances désintéressées. Ils regrettent que l’individualisme ait un peu asséché les cœurs. Ils déplorent qu’on se heurte facilement à l’indifférence d’autrui.

Qu’on s’en méfie ou pas, autrui s’invite et parfois dicte sa loi dans la vie des camerounais. On obéit à des coutumes ancestrales parce qu’on ne veut pas froisser ses pairs. On fait foule sans trop réfléchir. Si les autres font ainsi, alors c’est bon, c’est bien.
Dans certains cas, on frôle tranquillement la désindividuation. L’attention de l’individu est plus dirigée vers l’extérieur, vers le groupe, que vers lui-même. Tout est dilué dans le groupe, identité propre et responsabilité personnelle. On entend alors des « chez nous les … on fait comme ça, qui suis-je pour faire autrement? ». Tout au long de sa vie, on cherche des groupes de référence, la tontine, l’amicale, les associations, etc. On appartient toujours à une famille, à un groupe, et on accepte plus ou moins les contraintes qui vont avec.
Même si on a une peur viscérale du regard d’autrui qui juge et condamne, personne ne penserait à s’y soustraire à la façon d’un hikikomori. Il arrive que l’individu laisse les autres dévaster sa vie, en les laissant prendre des décisions importantes à sa place (choix du conjoint, de la profession, de la religion, du candidat politique, etc). Le poids des autres est tellement fort que l’individu leur abandonne ses responsabilités, même s’il en est malheureux, il a de petits instants de réconfort à l’idée d’avoir fait ce que les autres attendaient de lui. Une femme préférera d’être battue encore et encore, plutôt que d’accepter qu’il soit clair pour tout le monde, surtout pour les autres, que son mariage est un fiasco. Le regard de l’autre paralyse ainsi certaines personnes.
Les individus au cou fragile, qui ne supportent pas le poids du jugement des autres sur leur tête, vivent des conflits intérieurs qui peuvent les mener vers un psychothérapeute, ou vers le pasteur, le prêtre, le marabout ou le guérisseur. Généralement, l’individu tait ces conflits, parce qu’il n’est pas facile de dénoncer les autres, ce magma informe et menaçant, qui dépouille l’individu de ses prérogatives, s’attribue et se gargarise de ses succès et le laisse seul, très seul, devant ses échecs. Les non-moi sont haïssables, mais je suis encore plus haïssable sans eux. Tel est le dilemme qui trotte peut-être dans la tête de certains camerounais.

Tout se mélange, les autres peuvent constituer un danger permanent, dans un schéma paranoïde on leur attribue toutes sortes de manœuvre mesquines, la sorcellerie c’est les autres qui ouvrent l’enfer aux autres. Paradoxalement, c’est de ces mêmes autres que certains attendent, souvent exigent, le geste qui sauve. La phrase d’un chanteur ivoirien résume ce paradoxe « les gens n’aiment pas les gens, mais les gens aiment l’argent des gens ». Autrui est bon ou mauvais selon ce qu’on attend de lui, et surtout selon ce qu’on a reçu de lui.
Pour profiter d’autrui, l’aimer ou le détester, c’est mieux quand on le côtoie. Il est communément admis que les altérités les plus dangereuses sont tapies dans l’entourage. « C’est ton propre orteil qui perce ta chaussure « , « l’ennemi ne dort jamais loin », la sagacité des rues de Yaoundé a parlé.
Autrui c’est la main qui tient le poignard dans ton dos, et c’est aussi la main secourable qui t’aide à attacher le colis de la solidarité.
Évidemment, il y a aussi au Cameroun des individus en crise dans leur relation avec autrui. S’il y a de moins en moins de fous et folles qui arpentent les rues de la capitale, grimaçant et nus comme des vers, par contre dans les institutions hospitalières adaptées, des névrosés passent des séjours plus ou moins longs, avec des prises en charge thérapeutiques et médicamenteuses plus ou moins importantes. Bipolaires, schizophrènes, maniaco-dépressifs, etc, vont en consultation chez des spécialistes, psychologues, psychiatres et psychothérapeutes, la seule chose qu’on déplore c’est encore leur nombre très limité.

Sartre a dit « l’enfer, c’est les autres », puis il a lui-même continué à faire avec les autres, parce que l’enfer sans les autres est peut-être pire. Il a encore dit: « autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même : j’ai honte de moi tel que j’apparais à autrui ». Il faut les autres pour qu’un individu se sente lui-même, même s’il court le risque de se noyer dans les autres au point de ne plus être lui-même. La question de l’altérité sera toujours au cœur des relations humaines, parce que l’autre c’est la relation au monde, c’est le courage d’être soi pour soi, enfin d’être pour les autres. Faut-il encore rappeler ce principe de sagesse qui a traversé des millénaires ? « Traite autrui comme toi-même ».